Le Droit Japonais, un incontournable
« Il faut honorer l’harmonie », ainsi commence le code des 17 articles du prince Shotoku, première manifestation du droit au Japon en l’an 604. Cette phrase traduit une constante du tempérament japonais à l’égard de la règle de droit. Dans la doctrine confucéenne, le droit représente davantage un risque de troubles et d’incertitude pour l’ordre social qu’une garantie de sécurité. L’harmonie entre les individus appelle des règles flexibles et des moyens rapides d’apaiser les différents entre eux. L’adhésion à la vie du groupe doit être naturelle et volontaire, fondée sur le non-droit et les règles informelles de conduite. En clair, l’harmonie bien comprise doit rendre inutile la contrainte juridique. Cette attitude est restée inchangée tout au long de l’histoire du Japon. » écrivait Jean Hubert Moitry dans « Le Droit Japonais » aux Éditions Que Sais- je en 1989.[i]
[i] Le Droit Japonais, P.3, Que Sais-je (PUF) par Jean-Hubert Moitry, ancien élève de l’École normale supérieure (1979-1982) et après une thèse sur le Tribunal de cassation sous la Révolution française, il obtient l’agrégation d’histoire du droit (major du concours 1988)
Est-ce encore aussi vrai aujourd’hui, les auteurs et les praticiens en débattent.
« L’appréhension du droit japonais pour un étranger n’est pas chose facile. Derrière une similarité apparente, il cache, en effet, des différences appréciables de conception, d’interprétation et de pratique.
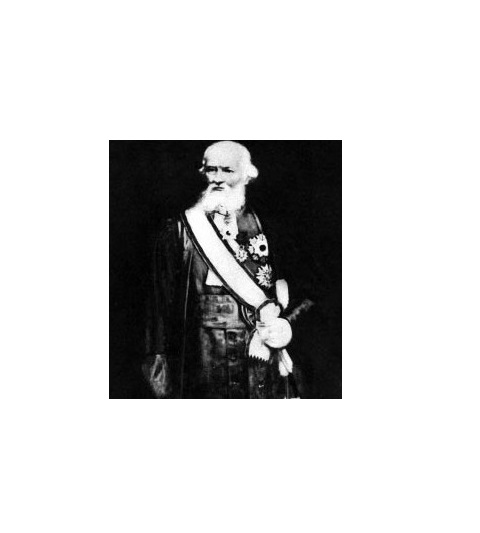
Il est vrai que nous ne sommes pas au Japon dans un système parfaitement orthodoxe. La codification des lois en France et en Allemagne n’est pas née du hasard. Elles ont, tout d’abord, en toile de fond la référence ultime au droit naturel véhiculant des valeurs fortement imprégnées de morale chrétienne pour lesquels le bien et le mal, le vrai et le faux, le juste et l’injuste doivent être clairement identifiés et distingués. Elles traduisirent, ensuite, sans les contredire, les règles sociales déjà établies ou stabilisèrent pour quelque temps une évolution en cours. Ainsi codifié, le droit inspire une relative confiance et joue pleinement son rôle de recours ultime pour le règlement des litiges. De la même façon, les droits anglo-saxons, par leur respect du précédent et de la règle de l'”equity” adhèrent à un degré sans doute plus accentué encore au système moral qu’ils régissent.
Le droit japonais, quant à lui, se trouve dans une situation intermédiaire qui est peut-être la cause de son apparente insaisissabilité et du discours contradictoire que l’on tient à son sujet, partagé entre une vision traditionnelle et celle des modernistes qui attribuent le maintien de la vision traditionnelle à un biais occidental non justifié dans le monde japonais d’hier et plus encore d’aujourd’hui.
Pays de coutumes non écrites, fondées traditionnellement tant sur la prédominance de l’autorité hiérarchique que la préservation de l’harmonie du groupe plus d’un côté comme de l’autre que sur le respect des droits individuels, le Japon s’est imposé à lui-même un système juridique, français et allemand, au départ, dont les fondements moraux et sociaux sont aux antipodes du sien. Son mérite était certes d’avoir pris conscience que pour lutter à armes égales contre la domination du monde occidental, il fallait lui emprunter ses propres lois et méthodes, mais nul ne s’étonnera que ce faisant la greffe ait mal pris, qu’au cadre emprunté de toute pièce, il semble parfois manquer le fond (ou l’âme).
Cette absence de référence à une règle supérieure qui dépasse le droit pour constituer les bases d’une civilisation donne parfois le sentiment d’un rigorisme excessif, comme si le droit devait être respecté pour la seule raison qu’il existe et non par référence aux besoins auxquels il doit répondre.
Cet emprunt de l’extérieur explique aussi la subsistance de la tradition en parallèle à la règle de droit, et par conséquent la possibilité pour les Japonais de recourir à l’un ou à l’autre système selon la nécessité du moment, ce qui ne manque pas d’accroître la perplexité des étrangers. Il en est ainsi par exemple dans les litiges contractuels où les uns pourront dire que c’est la loi du contrat qui s’applique sans exception et d’autres mettre en avant dans les mêmes circonstances l’abus de droit ou plus subjectivement encore la rupture des relations de confiance. Il en est de même du recours à des concepts plus flous tels que celui de « socialement acceptable » dans le droit du licenciement ou de l’« atteinte à l’ordre public » dans les cas d’usurpation d’appellations étrangères.
A l’inverse, les Japonais n’hésitent pas à être plus légalistes que les Européens dans les domaines du droit pour lesquels aucune tradition japonaise n’existait avant leur introduction. Ainsi, toujours dans le droit de la propriété industrielle, le fait par exemple que le droit des marques attribue la propriété de la marque au premier déposant a longtemps conféré aux usurpations une légalité sans recours et donné aux usurpateurs, à défaut du bon droit, une bonne conscience absolue. En application du principe de légalité, nombre de marques françaises notoirement connues ont pu être déposées au Japon par des spécialistes de l’usurpation de marques et ont dû être rachetées par leur véritable propriétaire pour des montants souvent astronomiques (au-delà parfois de cent millions de yens).
Ce légalisme est également sensible dans le respect absolu souvent exprimé à l’égard de la loi, celle-ci devenant l’ultime raison d’être indépendamment de ce qui a motivé son élaboration. Ainsi, je fus frappé de la réponse des autorités japonaises faites à la demande des Etats-Unis d’introduire un système renforcé de protection du secret pour les inventions liées à la défense nationale. Il fut, en effet, répondu qu’imposer un tel secret était impossible parce que contraire aux règles fondamentales du droit des brevets qui prévoit précisément la publication des nouvelles inventions afin de les faire connaître du public. Mais sachant que la même obligation de publication des brevets est une règle mondialement appliquée, le fait d’opposer l’existence d’un principe légal bien connu aux négociateurs américains ne répondait pas à la question qui était seulement de savoir si les raisons invoquées par les Etats-Unis étaient suffisamment graves pour justifier qu’il soit fait exception au principe. » (fin de 1989).
J’étais tenté aujourd’hui de supprimer cette dernière évocation tant elle me paraissait trop simpliste mais c’est à ce moment même qu’elle fut confirmée avec une acuité particulière. Pour mieux assurer sa sécurité économique, le Japon vient, en effet, d’imposer le secret sur les brevets dans les secteurs d’activité dits sensibles par une loi du 11 Mai 2022. Le principe autrefois inviolable de la publicité des brevets tombait ainsi au bénéfice des intérêts japonais sans que plus aucun spécialiste ne s’en émeuve.
Indépendamment de cette dernière confirmation, opportune et inattendue, il n’est pas indifférent cette fois de porter un regard plus approfondi sur ce qui n’était à l’époque qu’une approche personnelle encore trop peu fondée sur une recherche documentaire.
Apparemment, ce qui précède n’exprimait que la partie immergée des opinions qui opposent sur le sujet les spécialistes du droit japonais entre traditionalistes et modernistes. Les exemples qui suivent en sont l’illustration parmi d’autres.
Mais avant de les évoquer, il peut être utile de vérifier si la définition du droit ne contenait pas déjà historiquement le germe de leur différence d’appréciation entre l’Europe et le Japon.
Pour l’Europe, les définitions ont évolué dans le temps du droit romain au droit de notre temps. En dépit de leur diversité, le point commun qu’on peut y trouver est l’idée que le droit a pour fondement l’idée de justice et pour fonction celle de régir les rapports entre les hommes dont le respect est assuré par l’autorité publique. On y retrouve ainsi mélangé avec plus ou moins de force pour chacun au cours de l’histoire un concept moral, entre les droits individuels et ceux qui relèvent de la collectivité.
Quant au Japon, une recherche sur la construction étymologique du mot HO 法 (« droit ») et sur la perception de ce mot pour les japonais apporte quelques réponses. Selon le professeur Kitamura Ichiro que cite Jacques Dupouey dans son ouvrage « Passeport pour le Japon des Affaires »[iii]: « L’idéogramme HO (originalement on utilisait un idéogramme plus compliqué en chinois 灋) a été conçu dans l’ancienne Chine, exprimant l’image qu’on enferme un curieux animal favori de l’empereur dans une petite île entourée d’un étang, afin de l’empêcher de fuir tout en le mettant à paître. D’où le sens de peine ou de réglementation en même temps que celui de méthode, exemple ou standard : le droit est essentiellement en Chine destiné à servir de standard pour les fonctionnaires dans leur application des ordonnances impériales… Et puis le mot est entré au Japon avec le bouddhisme : c’est donc dans le sens des lois extrêmes bouddhistes que les Japonais ont appris la notion de HO. Mais par la voix de la lecture japonaise du mot, ils l’ont assimilé à la notion japonaise de NORI, règlement édicté par un seigneur divin, donc par le Tenno (empereur) ou le gouvernement, qui représente un double de la notion chinoise du droit. Et c’est là que s’est ajouté le droit occidental. »
[iii] Passeport pour le Japon des Affaires, Jacques Dupouey page 59 aux éditions L’Harmattan 2007
On en tire la conclusion qu’à son origine le droit est avant tout régalien, et sans qu’aucune référence ne soit faite aux critères énoncés plus haut pour caractériser le droit occidental. Et sa conséquence est le constat, comme l’écrit Jean-Hubert Moitry cité en préambule, que « Le droit japonais d’aujourd’hui est le résultat d’une synthèse qui n’a effacé que partiellement les traits dominants du passé. » [iv]
[iv] Extrait du « Que sais-je » précité p. 86
Cette juxtaposition serait bien pour le professeur Yosiyuki Noda [v] la cause de l’aversion traditionnelle des Japonais à l’encontre de notre droit. Cela ressort de ces quelques lignes de son livre Introduction à la Loi Japonaise : « Les Japonais conçoivent généralement le droit comme un instrument de contrainte que les États utilisent lorsqu’ils souhaitent imposer leur volonté. La loi est donc synonyme de peine pour un Japonais honorable; la loi est quelque chose d’indésirable, voire de détestable, quelque chose à tenir le plus loin possible. Ne jamais utiliser la loi ou être impliqué dans la loi est l’espoir normal des gens honorables. Poursuivre quelqu’un en justice pour garantir la protection de ses propres intérêts, ou être mentionné devant un tribunal, même dans une affaire civile, est une chose honteuse et l’idée de honte… sera la clé de voûte du système de la civilisation japonaise. »[vi]
[v] Cité par Hirose Oda dans « Japanese Law » Edition OXFORD 199 (p.5)
[vi] Yosiyuki Noda, Professeur de droit Comparé à l’université de Tokyo, spécialiste du droit français
La primauté du collectif sur les droits individuels était apparente lors de l’introduction à l’époque Meiji du droit occidental au Japon et notamment, à tout seigneur tout honneur, lors de l’introduction du code civil sous la direction de Gustave Boissonnade. Son principal opposant, Yatsuka Hozumi, n’écrivait-il pas « …le droit civil moderne met l’individu au premier plan (nous sommes en 1878 !) et oublie très souvent que les biens sociaux sont les fruits de la société elle-même » [viii].
[vii] Dupouey page 62
Il ajoute pour conforter l’idée que le droit japonais conserve une part irréductible en dépit de ses emprunts au droit occidental : « La réception du droit étranger au Japon a été sélective, c’est-à-dire qu’elle n’a été introduite que dans la mesure où elle répondait à des demandes sociales spécifiques de l’époque…. Le Code incorporait les parties considérées comme les plus appropriées, quelle que soit la source. L’un des auteurs du Code a déclaré plus tard que les mesures législatives étaient recueillies dans tous les pays civilisés et que le code était le fruit d’une jurisprudence comparée. Cela n’a pas été possible sans comprendre et considérer la réalité sociale alors existante à l’époque. Afin de répondre aux conditions spécifiques du Japon, le droit étranger a souvent été modifié, parfois au point que son origine est devenue difficile à identifier. Cet examen attentif de la réalité sociale existant au Japon a minimisé les frictions entre les nouvelles lois et les pratiques sociales établies… Il serait assez insignifiant de comparer dans le vacuum les droits pris isolément en tant qu’un mécanisme indépendant, le droit faisant partie intégrante d’une civilisation…[viii]
[viii] Cité par Hirose Oda « Japanese Law » p.5
Le fait est que les Japonais tendent à raisonner et à se décider en tenant toujours compte des circonstances extérieures et de la réaction éventuelle de leurs partenaires ce qui pour un esprit français est jugé comme un manque d’indépendance d’esprit (l’antidote à la soumission).
La vision ainsi promue par les juristes japonais, et généralement acceptée par leurs homologues étrangers, que le droit japonais a des spécificités non transposables et non contestables par les non japonais en raison de l’unicité dont ils requièrent la reconnaissance ne fait pas totalement l’unanimité. On se serait étonné du contraire, n’y a-t-il pas toujours quelque part un contestataire pour lequel le consensus recèle une anomalie. Parmi eux, figure en bonne place Jean-Louis Halperin dans son livre co-écrit avec Naoki Kanayama[x] Droit japonais et droit français, au miroir de la modernité. Ils écrivent : « La recherche d’un esprit du droit japonais distingué nettement de l’esprit du droit français, nous paraît reposer sur des bases contestables.
Pour les occidentaux le risque a toujours été de céder à l’exotisme orientaliste, en voyant partout les traces d’une spécificité japonaise qui serait toujours seule en son genre – l’Uniqueness de l’identité japonaise ou Nihonjinron de beaucoup de spécialistes de la culture. Il est tout aussi dangereux, pour un Japonais, de croire à la singularité d’un esprit français, en relation avec le pacte républicain et aussi original que l’American Way of life ou le Sonderweg allemand. Dans ces deux visions du Japon et de la France, la spiritualisation du droit suppose que les systèmes juridiques ont une âme à temporelle, toujours identique à elle-même. Que l’on cherche à décrire cet esprit des lois comme une combinaison d’institutions dont la configuration nationale serait réductible à la comparaison–sous la forme d’un mariage, d’un divorce, d’un État, d’une administration « à la française » ou « à la japonaise »–ou comme l’expression de « principes fondamentaux » déterminant l’ensemble du droit–une conception de la liberté, de l’égalité ou de la solidarité qui serait propre à chacun de ces systèmes juridiques–, l’illusion est la même. »
[x] Jean-Louis Halperin dans son livre co-écrit avec Naoki Kanayama[i] « Droit japonais et droit français, au miroir de la modernité » dalloz collection « à droit ouvert ». P. 12
Dans sa préface à son livre précité « Japanese Law », Hiroshi Noda exprime aussi ses réserves sur l’idée que les japonais seraient si différents au regard des autres :
« Au lieu de mettre l’accent sur les aspects particuliers du droit japonais, je me suis efforcé d’illustrer le système juridique japonais comme un système juste et rationnel fondé sur des valeurs partagées par les pays industrialisés. C’est parce que j’ai l’impression que, dans le passé, on a trop insisté sur le caractère unique du droit japonais. Cela a conduit à une perception du droit japonais comme un système particulier dans lequel derrière sa façade moderne subsistent encore des valeurs et des règles traditionnelles.
La tendance des Japonais à se représenter comme différents et uniques a peut-être contribué à développer cette perception…Dans tout système juridique, il y a toujours un fossé entre les lois et leur mise en œuvre Pour étudier le droit souverain, il faut aller au-delà du statuquo. Cela s’applique également au droit japonais tout aussi bien, bien qu’il n’y ait aucune preuve que l’écart soit plus important que dans d’autres juridictions.» Et d’ajouter quelques pages plus loin « Dans tout système légal, il y a un gap entre la loi dans les livres et la loi dans l’action. Cela s’applique à la loi japonaise tout aussi bien, mais l’assomption que ce gap serait plus large au Japon que dans les autres pays simplement parce que la loi étrangère a été introduite dans une société traditionnelle ne peut pas être établi ».
S’il est légitime de vouloir échapper à la tendance naturelle à vouloir absolument faire du Japon un monde à part, il n’y en a pas moins des signes objectifs qui le confirme bien au-delà de ce qu’on voudrait voir n’être qu’une perception (condescendante pour les étrangers et identitaire pour les Japonais).
C’est bien ce qu’exprime Ichiro Kitamura (p 52)[i] lorsqu’il qualifie le droit japonais de droit « mou » en raison de textes de loi relativement vagues et d’un nombre d’article moins nombreux que dans la plupart des pays de droit latin. En 1987, le code civil japonais comprenait 1046 articles contre plus du double pour le code civil français avec 2283 articles (1091contre 2296 en 2022). De même, le code du travail japonais comprenait 206 articles contre 3818 pour son équivalent français. L’écart s’est creusé depuis puisqu’il est passé en 2022 de 121 articles pour le Japon à 8331 pour la France.
[i] Etudes de Droit Japonais, Ichiro Kitamura, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Tokyo « Une esquisse psychanalytique de l’homme juridique au Japon (page 25 à 61)
Le faible nombre d’articles et la généralité de leur formulation ont pour inévitable conséquence de laisser une plus large place à l’interprétation par le juge. Ichiro Kitamura (page 54) n’hésite pas pour l’illustrer à recourir à des expressions presque triviales « les lois font au niveau de leur application et de leur interprétation l’objet d’une « mise en valeur élastique » (danryoku-teki-un’yô)… Notamment, on n’aime pas que les lois soient interprétées à la lettre, « à la mesure de la louche » (shakushi-jôgi) mais on exige un « dosage avec plus ou moins de Cuillérées » (Saji-Kagen). Ce langage reflète non seulement un vœu populaire mais quelque chose de plus structural de la juridicité japonaise.
En sus de la rareté des modifications des lois, il ajoute, toujours dans le même esprit, ce qui suit « Avec le concours du positivisme légal très net chez les praticiens, cela rend leur déduction d’un texte susceptible d’une interprétation large et donc d’un caractère téléologique. La pratique fait apparaître des règles juridiques comme une sorte de baguette magique (Uchide no kozuchi)… la même raison implique une autre conséquence, plus importante : l’application des règles de droit, peu nombreuses et de nature molle, dépend largement de l’analyse des faits de la cause ouvrant ainsi la possibilité d’un millier de casuistique. De là se dégage un certain factualisme dans l’appréciation juridique.… L’importance attachée à l’appréciation factuelle peut être expliquée notamment par le fait que les juristes tiennent compte de la part de la coutume ou de l’équité sous la forme de la recherche des faits : ils tentent inconsciemment à donner la parole aux éléments de faits qui implique un point de droit. »
La quantité limitée de lois et leur généralité ont aussi favorisé l’autoritarisme traditionnel de l’administration japonaise par la voie de ses directives d’application (gyosei shidô) dont la force coercitive tient plus à l’obédience des individus face au pouvoir qu’à la stricte volonté d’appliquer la loi, ce qui contraste singulièrement avec la force obligatoire des décrets en droit français. Le même Ichiro Kitamura illustre comme suit cette particularité (p 53) : « C’est un acte de canaliser, les comportements des particuliers, sur leur accord, dans un certain sens qui semble bon à l’administration dans l’application ou beaucoup plus souvent, en dehors, des dispositions légales, par diverses voies dites de « non-pouvoir » telles que le conseil, la recommandation, l’avertissement, la direction officieuse, etc. Les bureaucrates invitent les intéressés à faire ou à ne pas faire telle ou telle chose à l’occasion d’une requête formée par ceux-ci ou en les appelant spontanément à leur bureau. Bien qu’il leur soit théoriquement loisible de refuser, les particuliers s’y conforment le plus souvent, de peur de s’attirer une éventuelle disgrâce de l’administration, voire même une mesure de rétorsion.
Et ils vous diront : « On oserait mal se dresser contre les gens d’en haut », peut-être avec un léger ton de contentement… Malgré beaucoup de danger, danger de l’arbitraire, de l’absence de contrôle juridictionnel, cette pratique est largement suivie dans tous les ministères et appréciée même par les particuliers, et cela justement en raison de la souplesse des mesures prises à la différence de celle du droit strict… C’est un véritable soft Law. C’est aussi une mini-législation intérieure dont l’importance se trouverait rarement ailleurs. ». Ceux qui reprochent à la France l’omniprésence de l’administration ont trouvé là leur maître.
Par concomitance, il n’est pas non plus étonnant que les Japonais fassent preuve d’une faible litigiosité par rapport aux autres pays développés, même s’il existe des notables divergences sur les ratios à prendre en considération et sur les conclusions à en tirer relativement au bon ou au mauvais fonctionnement de la justice civile. C’est ainsi qu’en 2021 au Japon, 130.861 affaires ont été portées devant les tribunaux de district, qui sont la juridiction de premier degré en matière civile, commerciale, sociale et pénale, et 326 443 affaires ont été portées devant les tribunaux sommaires, soit au total 457.304 [i]cas à comparer avec ceux de la France, pays deux fois moins peuplé, dont en 2021 les juridictions civiles françaises ont été saisies de 1.679.114 cas[ii] soit près de cinq fois plus avec moitié moins d’habitants.
[i] https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2023/databook2023/db2023_212.pdf
[ii] https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/RSJ2021_Chapitre4.pdf
Et pourtant, les Français ont la réputation d’être moins prompts à saisir les tribunaux que les Américains et comme on le verra par ailleurs, le barreau hexagonal est en proportion d’une taille inférieure à celui des voisins européens.
D’aucuns diront que j’ai pris le parti de resasser les lieux communs sur la tradition pour parler du sujet, comme s’il fallait à tout prix que le Japon reste différent des autres en restant aveugle aux changements qu’il subit ou qu’il initie de lui-même selon le cas. Il est vrai que dans le domaine du droit, l’influence américaine a fait très clairement évoluer à la fois les conceptions et les comportements, au point qu’il est devenu possible de dire qu’ils sont désormais à l’égal de ceux des autres pays occidentaux, particulièrement dans le droit des affaires.
La formation des avocats japonais dans les universités américaines associée à l’accroissement des investissements étrangers au Japon y a contribué. Il n’en reste pas moins que la tradition évoquée dans ce chapitre reste en toile de fond, certes plus cachée mais toujours là, et qu’il est difficile d’échapper au sentiment qu’elle pourrait reprendre le dessus si les circonstances l’imposaient. Sans doute est-ce parce que les idées qu’elle sous-tend restent à leurs yeux toujours aussi pertinentes.
Aussi contestée soit-elle, la spécificité de l’appréhension du droit par les Japonais, nous ne manquerons pas de la retrouver dans nombre de situations dans lesquelles il est en jeu, et notamment dans les relations contractuelles (voir Contrat et négociation) et dans le mode de résolution des litiges (voir Arbitrage et Médiation). Sans évoquer, autre signe, la persistance de l’usage de la langue japonaise dans les relations internationales à l’inverse des pays voisins du Japon, la Corée du Sud au premier chef.
[i] Le Droit Japonais, P.3, Que Sais-je (PUF) par Jean-Hubert Moitry, ancien élève de l’École normale supérieure (1979-1982) et après une thèse sur le Tribunal de cassation sous la Révolution française, il obtient l’agrégation d’histoire du droit (major du concours 1988)
[ii] « Regard sans complaisance des étrangers sur le Japon » publié en 1988 aux éditions Keirinshobo
[iii] Passeport pour le Japon des Affaires, Jacques Dupouey page 59 aux éditions L’Harmattan 2007
[iv] Extrait du « Que sais-je » précité p. 86
[v] Yosiyuki Noda, Professeur de droit Comparé à l’université de Tokyo, spécialiste du droit français
[vi] Cité par Hirose Oda dans « Japanese Law » Edition OXFORD 199 (p.5)
[vii] Dupouey page 62
[viii] Cité par Hirose Oda « Japanese Law » p.5
[ix] Cité par Jacques Pouey p. 16
[x] Jean-Louis Halperin dans son livre co-écrit avec Naoki Kanayama[1] « Droit japonais et droit français, au miroir de la modernité » dalloz collection « à droit ouvert ». P. 12
[xi] Etudes de Droit Japonais, Ichiro Kitamura, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Tokyo « Une esquisse psychanalytique de l’homme juridique au Japon (page 25 à 61)
[xii] https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2023/databook2023/db2023_212.pdf
[xiii] https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/RSJ2021_Chapitre4.pdf
